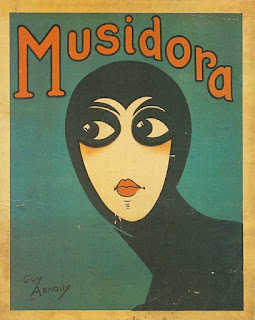à Franz
On se déplaçait
sans savoir où cela nous mènerait. Le voyage valait autant que son
but : quitter un endroit pour en rejoindre un autre ; un endroit
que l'on avait, d'ailleurs, le plus grand mal à distinguer de
l'horizon. Parfois, le mot d'horizon était bien précis pour décrire
la mélasse dans laquelle nous avancions.
Pour ma part,
j'avais abandonné les cartes pour ne me fier qu'aux récits des
voyageurs. Même s'ils décrivaient un paysage disparu, ils me
livraient son âme et, par là-même, la possibilité de suivre mon
propre chemin. Nul compagnon de voyage avec moi, à peine quelques
auberges, ça et là, où une hôtesse plus ou moins bien disposée
me tendait une tasse pour étancher ma soif.
J'ai vieilli sur
ces sentiers en glanant le peu de sagesse que m'offraient les
rencontres, silhouettes qui éboulaient les cailloux quand elle
s'éloignaient.
Aujourd'hui, je marche toujours – que faire
d'autre ? – même si je suis plus sensible aux déclivités du
terrain. Les arbres sont devenus des présences et je m'arrête de
plus en plus souvent près des lacs pour capter les échos de ceux
qui s'y sont baignés.
Je ne suis plus
capable de mesurer le chemin parcouru. Aux grincements de mes genoux,
à mon dos douloureux, je devine que je suis loin de la cabane que
j'ai quitté dans ma jeunesse.
Les voyageurs que je croise – nous
prenons un thé pour échanger des nouvelles de la route – ne
peuvent m'en dire plus. Eux-mêmes, lorsque je regarde leur visage à
la lueur du feu, me semblent un peu hagards. Sans doute faut-il y
voir l'effet de la fatigue et de la poussière qui nous font comme un
masque à la fin de la journée.
Les femmes que
j'ai rencontrées ne songeaient guère à s'attarder. La plupart du temps,
nous cachions nos affaires derrière un rocher avant d'aller nous
allonger sous un buisson. Je garde le souvenir de peaux poivrées, de
morsures, de quelques mots échangés dans la timidité de l'aube.
Une ou deux avaient un regard de louve. Je ne les ai jamais revues.
L'orage me
surprenait rarement. Je veillais à surveiller le ciel car, ici, il
n'y a rien de plus pernicieux que de se laisser bercer par ses pieds.
Parfois, un chien
me rejoignait. Il s'agissait le plus souvent d'un corniaud au regard
vif qui frottait ses flancs contre mes jambes. J'aimais sa compagnie,
sa façon d'errer devant moi sans jamais se perdre. La nuit, à mes
côtés, il lui arrivait de redresser la tête pour scruter les
ténèbres avant d'entamer un dialogue silencieux avec quelque chose
que je ne voyais pas. Il disparaissait au bout de quelques jours
aussi rapidement qu'il était apparu et, pendant un moment, je
sentais encore sa présence à mes côtés.