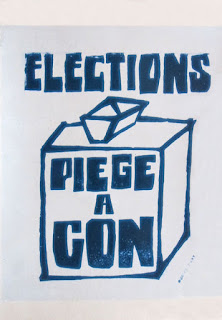dimanche 10 avril 2016
mercredi 6 avril 2016
Corvéables à merci
L’essence de la société (…)
est d’exempter
le riche du travail : c’est de lui donner de nouveaux organes,
des membres
infatigables, qui prennent sur eux toutes les opérations
laborieuses dont il
doit s’approprier le fruit. Voilà le plan que l’esclavage lui
permettait
d’exécuter sans embarras (…)
En supprimant la servitude, on
n’a
pas prétendu supprimer ni l’opulence, ni ses avantages. On n’a
pas pensé à
remettre entre les hommes l’égalité originelle ; la
renonciation que le
riche a faite à ses prérogatives, n’a été qu’apparente. Il a
donc fallu que les
choses restassent, au nom près, dans le même état. Il a
toujours fallu que la
plus grande partie des hommes continuât de vivre à la solde,
et dans la
dépendance de la plus petite, qui s’est approprié tous les
biens. La servitude
s’est donc perpétuée sur la terre, mais sous un nom plus doux.
Elle s’est
décorée parmi nous du titre de domesticité. C’est un mot qui
sonne plus
agréablement à l’oreille ; il présente à l’imagination une
idée moins
affligeante, et il ne signifie cependant à le bien examiner,
qu’une insulte
plus cruelle faite à l’humanité (…)
Il est libre, dites-vous !
Eh ! Voilà son malheur. Il ne tient à personne : mais aussi
personne
ne tient à lui. Quand on en a besoin, on le loue au meilleur
marché que l’on
peut. La faible solde qu’on lui promet, égale à peine le prix
de sa substance
pour la journée qu’il fournit en échange. On lui donne des
surveillants pour
l’obliger à remplir promptement sa tâche ; on le presse ; on
l’aiguillonne de peur qu’une paresse industrieuse et excusable
ne lui fasse
cacher la moitié de sa vigueur ; on craint que l’espoir de
rester plus
longtemps occupé au même ouvrage, n’arrête ses bras, et
n’émousse ses outils.
L’économie sordide qui le suit des yeux avec inquiétude,
l’accable de reproches
au moindre relâche qu’il paraît se donner, et s’il prend un
instant de repos,
elle prétend qu’il la vole. A-t-il fini, on le renvoie comme
on l’a pris, avec
la plus froide indifférence, et sans s’embarrasser si les
vingt ou trente sols
qu’il vient de gagner par une journée pénible, suffiront à sa
subsistance, en cas
qu’il ne trouve pas à travailler le jour d’après (…)
Il est libre ! C’est précisément
de quoi je
le plains. On l’en ménage beaucoup moins dans les travaux
auxquels on
l’applique. On en est plus hardi à prodiguer sa vie. L’esclave
était précieux à
son maître en raison de l’argent qu’il lui avait coûté. Mais le
manouvrier ne
coûte rien au riche voluptueux qui l’occupe. Du temps de la
servitude le sang
des hommes avait quelque prix. Ils valaient du moins la somme
qu’on les vendait
au marché. Depuis qu’on ne les vend plus, ils n’ont réellement
aucune valeur
intrinsèque. Dans une armée on estime bien moins un pionnier,
qu’un cheval de
caisson, parce que le cheval est fort cher, et qu’on a le
pionnier pour rien.
La suppression de l’esclavage a fait passer ce calcul de la
guerre dans la vie
commune.
Henri Linguet, Théorie des lois
civiles ou principes
fondamentaux de la société (1767)
Merci à J.L. et M.B. pour leur envoi.
lundi 4 avril 2016
Carte de loin (4)
M., le 2 avril 2016.
Je
suis arrivé à M. par la petite route du bas. Je n'ai croisé
personne dans la rue principale. Le printemps n'était pas assez là
pour poser sa chaise devant la porte et la plupart de ceux que je
connais étaient aux champs. J'ai laissé mon sac au pied d'un des
marronniers de la place, juste en face du monument aux morts et,
comme je le fais chaque fois que j'arrive dans une localité, je suis
allé déchiffrer le nom des tués de 14-18. J'y ai retrouvé deux
cousins et j'ai calculé qu'un tiers des hommes de la commune n'était
pas revenu de cette boucherie.
Après avoir lu une dernière fois la liste des noms gravés sous les pieds du poilu, je suis allé m'asseoir près du marronnier. Nous étions en pleine période de commémoration de cette guerre et j'ai pensé à la lettre qu'écrit le Commandant Delaplane à Irène de Courtil à la fin du film de Bertrand Tavernier La Vie et rien d'autre. Je me suis dit qu'elle esquissait le seul hommage que nous pourrions rendre à ces hommes ainsi assassinés au lieu de la bouillie médiatisée et patriotarde que l'on connaît.
Après avoir lu une dernière fois la liste des noms gravés sous les pieds du poilu, je suis allé m'asseoir près du marronnier. Nous étions en pleine période de commémoration de cette guerre et j'ai pensé à la lettre qu'écrit le Commandant Delaplane à Irène de Courtil à la fin du film de Bertrand Tavernier La Vie et rien d'autre. Je me suis dit qu'elle esquissait le seul hommage que nous pourrions rendre à ces hommes ainsi assassinés au lieu de la bouillie médiatisée et patriotarde que l'on connaît.
« Post-scriptum :
c’est la dernière fois que je vous importune avec mes chiffres
terribles. Mais par comparaison avec le temps mis par les troupes
alliées à descendre les Champs-Elysées lors du défilé de la
Victoire, environ trois heures je crois, j’ai calculé que, dans
les mêmes conditions de vitesse de marche et de formation
réglementaire, le défilé des pauvres morts de cette inexpiable
folie n’aurait pas duré moins de onze jours et onze nuits.
Pardonnez-moi cette précision accablante.
A
vous, ma vie... »
jeudi 31 mars 2016
Carte de loin (3)
Je quitte le hameau de
P., quatre maisons aux portes serties de vigne construites au pied du
causse. Je grimpe bientôt à l'ombre d'une forêt de châtaigniers
et de hêtres et, à mi-pente, débouche sur un grand champ où paît
une centaine de brebis aux yeux cerclés de noir. Sous un chêne,
près d'abreuvoirs en aluminium, le berger, un jeune type blond d'une
trentaine d'années, dispose des blocs de sel. On se salue et
entamons la conversation sans façon.
Vêtu d'un bleu de travail, de
bottes en caoutchouc et d'un tee shirt, il a croisé les mains sur son
torse et garde le regard fixé sur les brebis. Comme beaucoup de
paysans que je connais, il est d'une pudeur que poivre un accent dont
la rugosité est prompte à la saillie. La sympathie est immédiate.
Il est né à F., comme moi, et sa famille habite le hameau depuis
plusieurs générations. Il a repris l'exploitation de son père il y
a sept ans et se plait dans ce métier qui n'est pas dépourvu de solitude. « Quelle fille a envie de se marier à
un paysan, aujourd'hui ? ».
Bien sûr, nous parlons du prix de
la viande et des difficultés que connaît la branche ovine. Les
règlementations européennes le désarçonnent. Même si je sens
chez lui un certain fatalisme, il est révolté par le puçage
obligatoire de ses brebis. Il lève un index vers le ciel :
« Vous vous rendez compte : ils peuvent suivre mon
troupeau par satellite ! ». L'image déplaisante de cet espion
arien plane un moment au-dessus de nos têtes. À cet instant, nous nous
rappelons ce qu'est notre monde : une sphère bourdonnante sans
centre ni périphérie qui fait de ce coin de bois l'illusion d'un
refuge. Les syndicats ne font pas grand chose. Il ne se sent pas
écouté. Il ajoute alors quelque chose qui me cloue : « J'ai lu La
lettre aux paysans de Giono, c'est vrai ce qu'il écrit. ».
Je lui demande comment il est arrivé à lire ce texte. Il me réponds
qu'un ami lui a offert le bouquin et que, bien que sceptique au
début, il a été conquis par les mots de l'écrivain. « C'est
un type qui a compris ce qu'était un paysan ». Une bouffée de joie m'envahit à entendre les mots du poète ainsi confirmés par cet
homme. Je comprends le sentiment de solitude qu'il doit éprouver
dans une réunion de la FNSEA...
Les brebis se sont rapprochées, sans
doute attirées par le sel. J'ai encore un peu de chemin à faire avant la nuit.
Nous échangeons deux ou trois mots puis on se sert la main. Il
regagne son champ, je reprends mon ascension vers le plateau alors
que se mélangent en moi les sentiments d'incomplétude et
d'émerveillement qui me hantent chaque fois que je sors d'une bonne
rencontre. Le causse apparaît peu à peu avec le vent. Je m'engage sur un
chemin environné de muret en pierres sèches. Devant moi, un horizon de collines m'offre le
ciel. Allons, j'ai encore assez de soleil pour rejoindre ma
destination.
lundi 28 mars 2016
Carte de loin (2)
L.,
le 28 mars 2016.
La
petite départementale serpente entre des champs de vignes et des
bois d'yeuses. Nous roulons au milieu de ce paysage que Marc connaît
bien. Il est né ici et, pendant 30 ans, en a parcouru les routes
pour le compte d'une compagnie d'assurance.
A
sa retraite, il a été élu conseiller municipal à L. et a pu
mesurer la part d'impuissance du politique face aux intérêts
particuliers. Pourtant, malgré son âge et une retraite confortable,
il ne s'est pas résigné à abandonner la res
publica. Il est
visiteur de prison et se rend régulièrement dans les maisons
d'arrêt du pays. Je sais qu'il va de temps en temps Paris où il a
pris quelques responsabilités dans les instances de cette
association. Marc
me fait penser à un romain de l'antiquité : le cheveux court et
blanc, la peau halée, cet homme mince s'exprime avec la sobriété
de certaines lettres de Pline le jeune lorsqu'il écrivait de sa
villa de Stabies. Nous allons débroussailler les alentours de son
cabanon qui se trouve près de T. Je devine l'attachement qu'il porte
à cet endroit par le soin qu'il met à l'entretenir avec son épouse
loin des tracas de la civitas.
Quelques
villas annoncent Marc que nous traversons bientôt. C'est un joli
village de 3000 âmes perché sur un promontoir dominant l'A.
Quelques rues en pente s'étoilent depuis des placettes ombrées par
des platanes et une église au beffroi rectangulaire caractéristique
des villages de la région. Avec les artisans et les fonctionnaires,
vivent ici de vieilles familles paysannes qui cultivent encore la
vigne et l'olive autour de la commune.
Marc
me montre sa maison natale. C'est un petit immeuble ocre du XIXe
situé au milieu de la rue principale. Trois locataires lui
permettent d'entretenir ce lieu où il a vécu une enfance entre deux
parents qui ne s'aimaient pas et, plus tard, dans une pension tenue
par des religieux qui furent l'origine du solide anticléricalisme
qui le caractérise chaque fois que nous parlons de religion.
A
la sortie du village, nous nous garons devant la coopérative
viticole pour y acheter quelques bouteilles. Le bâtiment, construit
dans les années 30, a été refait récemment : on a enlevé le
crépi pour dénuder les pierres et une grande porte vitrée permet
au visiteur de distinguer, depuis le parking, les cuves et les
bouteilles qui y sont entreposées. Là, chaque année, Marc fait
presser les raisins de l'hectare qui s'étend devant son cabanon.
Cinsault, Syrah et Mourvèdre composent un vin léger que nous
boirons à midi.
Après
quelques kilomètres, nous arrivons au cabanon. Je suis frapppé par
la beauté du lieu. La petite maison de pierres sèches est bâtie à
mi-pente d'un vallon où vignes, pins et restanques cohabitent
harmonieusement. Nous descendons de la voiture et je pense à
Giono qui disait que tout le bonheur
des hommes
est
dans de petites vallées. Marc sourit, conscient du charme qui saisit
chacun des visiteurs qu'il amène ici. D'un geste auguste, et
décidément très romain, il m'indique la vingtaine d'oliviers qui
lui fournit, chaque année, quelques litres d'une huile très douce
qui fait merveille dans une salade.
Nous
sortons les outils de la camionnette. Machettes, sécateurs, rotofil,
tronçonneuse... Les deux restanques qui surplombent la petite
construction n'ont pas été nettoyées depuis cinq ans. La garrigue
a repris ses droits : cistes et pistachiers, enserrés dans une
salsepareille tenace, voisinent avec des buissons de chênes kermès.
Nous nous mettons au travail pour profiter de la fraîcheur du matin
et progressons bientôt dans les senteurs des buissons de thym que
nous foulons au fur et à mesure de notre avancée.
A
midi, nous déjeunons sous la tonnelle du cabanon et c'est un plaisir
que de se réjouir ici un verre de vin à la main. Le soleil de mars
n'est pas mordant, le dos appuyé au mur du cabanon, je peux étendre
mes jambes sous sa chaleur bienfaisante. Chaque fois que je porte le
verre à ma bouche, je sens l'odeur de sève qui imprègne mes mains.
Le silence nous enveloppe car il est trop tôt pour les cigales et,
depuis que nous sommes ici, je n'ai vu passer qu'une seule voiture
sur la petite route qui passe en contrebas.
À
deux heures, nous reprenons le travail pour couper à la machette les
derniers buissons qui ont échappé au rotofil. J'en profite pour
ramasser les pierres qui ont chu des murets. Lorsque le soleil
effleure le sommet des pins, nous avons dégagé la totalité des
deux restanques. Au milieu de l'une d'elle, Marc a épargné deux
oliviers sauvages. "Je les grefferai dans quelques jours,
dit-il". Le travail est terminé. Dans le vallon, l'air s'est
fait bleuté, annonçant l'arrivée de la fraîcheur nocturne. Il est
temps de rentrer.
mercredi 23 mars 2016
Pour un boycott actif de l'élection présidentielle
Il faut lancer, non pas une «primaire» mais une campagne de boycott de l’élection présidentielle pour délégitimer la structure actuelle du pouvoir.
Pourquoi une «primaire» à gauche ? La première motivation de
ceux qui l’ont proposée est d’éviter de voir imposer à la
gauche un candidat calamiteux et qui a fait ses preuves. Il s’agirait
de donner à cette élection et donc, plus largement, à
l’institution de la présidence élective, davantage de légitimité
démocratique, en soustrayant le choix du candidat aux seules
manœuvres tortueuses de l’appareil des partis.
Ces objectifs sont largement illusoires. Quel que soit le candidat
choisi, on peut être sûr que, s’il est élu, il fera le contraire
de ce qu’il a promis. Et puis, ce n’est pas une primaire ouverte
qui conférera un caractère authentiquement démocratique à une
institution d’inspiration profondément bonapartiste. En France, le
pouvoir du président n’est limité par aucun contre-pouvoir réel,
surtout depuis que la réforme constitutionnelle, qui a ramené la
durée du mandat de sept à cinq ans, a pratiquement mis le
président à l’abri du risque de «cohabitation».
Mais, aujourd’hui, le caractère non démocratique - en fait,
antidémocratique - du système de pouvoir dans les pays développés
tient à des causes infiniment plus profondes que le vice des
institutions. C’est que le fonctionnement de la démocratie
représentative se trouve radicalement faussé : le président et
plus généralement les élus du pouvoir central agissent moins que
jamais en tant que mandataires de leurs électeurs mais en tant que
fondés de pouvoir du capital (les grosses sociétés, les banques et
leurs organes bureaucratiques), comme le démontrent les politiques
dites de «réforme» des gouvernements successifs. Certes, la
démocratie représentative constitue dans son principe même - la
représentation - une aliénation de la «souveraineté populaire» ;
et quant à son rôle de courroie de transmission des injonctions du
capital, il lui est consubstantiel. Mais la démocratie
représentative était née d’un compromis négocié dans le sang
des révolutions du XIXe siècle entre les exigences
dictatoriales du capital et l’aspiration profonde des couches
populaires à la maîtrise de leur vie et de leur destin collectif :
aux détenteurs et aux gestionnaires du capital, la domination des
rapports de production et d’échange et l’essentiel de la
richesse ; aux citoyens prolétaires, certains droits limitant
l’arbitraire capitaliste, une part, toujours à défendre, de la
richesse produite par eux, la responsabilité de maintenir la paix
civile et sociale, l’impôt du sang et une «souveraineté»
politique en grande partie formelle. Aujourd’hui, il semble que le
capital juge encombrantes ces institutions et parasitaire l’exercice
de la «souveraineté du peuple», même tenue en lisière par le
système représentatif…
La crise grecque a fait éclater au grand jour et avec une
évidence théâtrale la rupture de ce compromis. Les personnages y
ont joué crûment leurs rôles : mépris insondable des
gestionnaires du capital pour la «souveraineté populaire» et
inconsistance des représentants de celle-ci, qui se sont finalement
comportés comme s’ils étaient profondément convaincus de
l’insignifiance de leur légitimité démocratique…
Qu’on ne nous rabâche plus que capitalisme et démocratie
libérale - le couple suffrage universel et «droits de l’homme» -
sont génétiquement associés. Les contre-exemples abondent, à
commencer par celui de la Chine. Mais sans chercher si loin : quand
la France, les Pays-Bas et l’Irlande votent «mal», le pouvoir
n’en tient aucun compte ; quand la «sécurité» entre en jeu, ce
sont les pouvoirs de police qui se renforcent, et les libertés qui
trinquent.
On peut se demander si cette perte de consistance des institutions
prétendues démocratiques ne se répercute pas, chez ceux qui
peuplent ces instances, en une inconsistance intellectuelle et
morale. Le niveau des débats entre les candidats républicains à la
présidence du plus puissant Etat du monde a de quoi nous donner
froid dans le dos…
En France, on n’en est certes pas là, mais quelle médiocrité
! Face à l’énormité des problèmes ou des crises imminentes, une
rhétorique creuse, une sottise rusée. Alors, à quoi bon une
«primaire», si c’est pour avoir à choisir entre la peste et le
choléra, ou entre tel et tel petit politicard, d’un sexe ou de
l’autre.
L’impasse actuelle rend opportune une remise en cause du système
politique - ou antipolitique - existant. Il faut lancer, non pas une
«primaire» mais une campagne de boycott de l’élection
présidentielle pour délégitimer la structure actuelle du pouvoir.
Mais pour, du même coup, redonner un sens à la souveraineté
populaire, il faut aussi que ce boycott ne se limite pas à
l’abstention ou au vote blanc, mais débouche sur une intervention
démocratique positive et que les partisans du boycott se
regroupent, forment des comités et débattent, non pas du choix d’un
individu, qui irait exercer le pouvoir à notre place, mais des
transformations de l’organisation politique et sociale, qui
redonneraient à chacun d’entre nous les moyens d’une existence
décente et une prise sur notre destin collectif.
Par Hélène Arnold Traductrice Daniel Blanchard Ecrivain,
traducteur Jacques Blot Auteur, comédien Jacques Signorelli, Michel
Veyrières, Laurent Rivierretous sont d’anciens membres de
Socialisme ou Barbarie et Fabien Vallès Compositeur Claire Lartiguet
Professeure Richard Wilf Journaliste Jacques Duvivier Conseiller aux
prud’hommes Gianni Carrozza Animateur de «Vive la sociale» sur
FPP (106.3) Pierre-Do Forjonnel Enseignant retraité, ancien du
22 mars.
boycottactif@gmail.com
boycottactif@gmail.com
par le COMITÉ POUR UN BOYCOTT ACTIF DE
L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
lundi 21 mars 2016
Carte de loin (1)
L. le 19 mars 2016.
Il y a cette gémellité, magie immédiate qu'il est
difficile de dissiper, image trompeuse car les soeurs, sous certains
aspects, ne se ressemblent pas du tout.
Il faut creuser un peu,
s'attarder chez elles, comme je l'ai fait, pour cerner leurs contours et
découvrir que Karine a en elle une noirceur qui, de l'avis même de
ses intimes, détonne : pour elle, le verre, à moitié vide,
est empli d'une eau saumâtre. Lorsque je la regarde, je ressens,
avec un plaisir frissonnant, le souffle des hauteurs abandonnées –
c'est un automatisme poétique : le visage de Karine évoque un
sommet que j'ai escaladé, quelques années auparavant, au plus
désolé des alpes provençales. À trois milles mètres d'altitude,
sur ce vaste crane de pierre dénudée où le vent sciait les yeux, j'avais goûté le plus vif de cette solitude et éprouvé l'absence
de toute présence divine, la preuve de l'irrémédiable solitude de
l'homme. J'avais éprouvé cette ascension comme un avertissement :
la désolation ne s'offre qu'aux athées conséquents.
A mes yeux, Karine traîne avec elle un monde aux enveloppements ténébreux
où les événements fonctionnent à l'instar de pieuvres aux yeux de
soie. C'est un univers fait de velours dangereux, de ciels
tourmentés, d'espoirs battus en brèche, tout un barnum d'effets
atmosphériques qui donne à sa présence la beauté d'une entrée de
tempête.
Quant à Lucile, c'est évident : elle est le
lendemain de cette tempête, le signe que tout déchainement aspire
au nirvana et que les gouttes d'eau qui perlent aux aiguilles des
pins peuvent transcender leur état de fouet pour accéder à celui
de perles. Lucile n'est pas seulement douce, elle sourit avec
précaution, déposant sur les êtres et les choses un or qui
rassérène. J'adore sa façon de saisir les choses avec une
curiosité qui hésite entre l'émerveillement et un clin d'oeil à
la « vous-m'avez-compris ».
mercredi 16 mars 2016
On a fait son baluchon...
...et
on va se balader dans le monde réel, faire quelques rencontres,
discuter un peu, couper du bois, prêter la main aux amis et aux
inconnus, gravir deux ou trois collines pour voir ce que ça donne. Pour
le courrier, laissez tout au bar du coin qui transmettra. J'enverrai une carte de temps en temps.
Love.
Love.
mardi 15 mars 2016
Inscription à :
Articles (Atom)