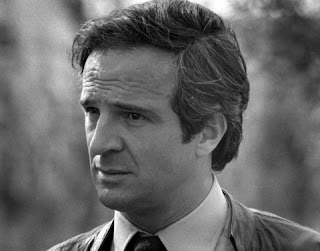jeudi 3 décembre 2015
Les montagnes bleues
Le secret perdu
mercredi 2 décembre 2015
Au café
De façon moins poétique, on pourra poursuivre cette réflexion sur l'importance de se réunir en lisant le billet de Frédéric Lordon sur "l'état d'urgence".
Pognon & Trouffion dans le même bateau
De l’Antiquité jusqu’à l’ère moderne, histoire monétaire et histoire politique semblent se confondre. Si l’Empire romain était parvenu à réaliser une relative unité monétaire (adaptée à ses efforts d’unification fiscale et de centralisation des finances publiques), sa chute, et le fractionnement de l’Europe « en de multiples et minuscules seigneuries » (Braudel), s’accompagnent d’une fragmentation de la monnaie.
Puis, même
si l’avènement des économies monétaires modernes est
inconcevable sans les renaissances urbaines et commerciales qui
animent l’Occident entre les XXIe et XVe siècles, ce n’est
qu’avec la lente construction des Etats modernes et d’un système
interétatique compétitif que l’Europe s’est acheminé vers un
système monétaire composé d’une pluralité de monnaies
nationales. Relativement à l’ensemble de cette histoire (au moins
jusqu’à la Première Guerre Mondiale), peu d’historiens
s’opposeraient à la validité du syllogisme suivant :
« 1)
l’essentiel des monnaies a été frappée pour couvrir les dépenses
publiques, 2) l’essentiel des dépenses publiques est allé à
l’armée, donc 3) l’essentiel des monnaies a servi à payer
l’armée. »
Dans
l’Antiquité, où apparaissent les premières monnaies métalliques
(or et argent, puis bronze ou cuivre), la mainmise sur les mines
d’exploitation permettait le financement directement monétaire de
l’activité militaire, alors que les butins issus de cette activité
rendaient possible la formation complémentaire de trésors de
guerre. Comme le signalait déjà Weber, « le monnayage n’est
apparu, d’une manière générale, qu’en tant que création d’un
moyen de paiement militaire, non comme création d’un moyen
d’échange. »
A Rome, encore, « La
frappe [monopole d’Etat] était réalisée à partir des fonds pris
sur les butins et la monnaie servait, non à des fins économiques,
mais pour le paiement de l’armée. » L’armée occasionnait
donc « l’essentiel de l’injection de monnaie nouvelle dans
le circuit général », si bien que « la relation entre
les émissions monétaires et l’augmentation des légions est
clairement établie. » En conséquence, le destin de l’empire
était indissociable de la monnaie. L’expansion militaire de la
période républicaine a entraîné la capture d’importants butins
qui furent soit monnayés, soit conservés à Rome. La victoire de
César sur Marc-Antoine permit l’accaparement des réserves
égyptiennes, avant que Trajan ne mette la main, au IIe siècle, sur
les réserves d’or et d’argent des rois Dace.
Mais,
à partir du IIIe siècle, le reflux politique de l’empire, le
déclin de la production minière (notamment d’argent), alors même
que s’accentuaient les guerres frontalières, eurent pour effet un
déséquilibre budgétaire qui obligea l’Etat impérial à jouer
autant de manipulations monétaires (dégradation de la qualité des
pièces) que de mesures fiscales. L’une des conséquences fut
l’affaiblissement du niveau de vie militaire, le recrutement
coercitif et la multiplication des désertions.
La dislocation de l’empire, ainsi que le pillage monétaire dont il fut l’objet au Ve siècle, s’accompagnèrent d’une régression de la monnaie et, au IXe siècle, le Moyen âge comtal ouvrit la voie à la dispersion des frappeurs de monnaie liée à l’éclatement féodal. Le « Second Moyen âge » (XIIIe et XVe siècles) est alors marqué par un « féodalisme d’Etat », dont les guerres structurelles rendaient indispensable d’imposer la prépondérance de la monnaie royale (et la multiplication des ateliers monétaires au service du roi), d’élaborer une forme élémentaire d’administration fiscale et d’avoir recours à l’emprunt, dans le cadre d’une « augmentation » significative de l’Etat et de l’instrumentalisation naissante du grand commerce au service de ses objectifs politiques et militaires. Celle-ci devra toutefois attendre, pour s’affirmer pleinement dans sa forme mercantiliste, l’apport en métaux précieux que fournira la découverte des Amériques.
Jusqu’au XIXe
siècle, la généralisation du salariat et l’instauration d’un
système complet de marché, la majorité des biens courants sont
restés localement produits et consommés au sein d’économies
locales a priori faiblement monétarisées. C’est en
surplombant cette « civilisation matérielle », d’abord,
que s’est déployée l’alliance entre les impératifs guerriers
des Etats européens et le grand commerce, porteur d’innovations
financières depuis le XIIe siècle [emprunts publics, placement à
terme, compensation, lettre de change (comme instrument de crédit,
puis comme moyen de paiement), escompte, bourse, etc.].
On
retrouve donc, d’un côté, le besoin de financement traditionnel
de la guerre, dans une Europe où ne peuvent survivre les Etats
incapables d’accompagner la révolution militaire en cours et
l’enjeu du contrôle des routes commerciales maritimes d’une
révolution monétaire et financière. Dans cet esprit, Charles
Davenant, en 1695, pouvait reconnaître que « tout l’art de
la guerre est d’une certaine manière réduit à la monnaie ;
et, de nos jours, le prince qui peut le mieux trouver l’argent pour
nourrir, vêtir et payer son armée (…) est le mieux assuré du
succès. »
Mais, d’un autre côté, la période mercantiliste se distingue de l’Antiquité et du Moyen âge par l’importance prise par la connexion entre la capacité d’attraction des richesses déployées par le grand commerce et la mobilisation des ressources, l’unification et la monétarisation nationales, fondement de la richesse fiscale de l’Etat : « C’est la prospérité du royaume qui permet au Fisc d’alimenter le Trésor royal ; c’est la prospérité commerciale qui fait circuler les espèces précieuses, mesures et conditions de toute puissance. L’impôt se paie en monnaie d’or et d’argent, parce qu’ainsi se paient les soldats, les munitions, les espions et les alliés. »
L’enjeu
principal, dans ces conditions, est donc d’acquérir la position la
plus attractive dans la circulation internationale des capitaux, que
la rivalité entre Etats européens a étirée jusqu’à la
dimension transocéanique : sont financées, de cette manière,
à la fois la croissance économique interne et l’expansion
coloniale. Par exemple, la République des Provinces-Unies, entre la
proclamation de son indépendance en 1581 et son lent déclin au
XVIIIe siècle, a édifié son hégémonie en hissant l’intérêt
marchand au rang de raison d’Etat.
Selon Norel,
« Le premier essor hollandais provient de la liaison assurée
par les marchands des Provinces-Unies entre le nord et le sud de
l’Europe », et s’est renforcé, parallèlement à la
centralité de son commerce (portant notamment sur le blé) et la
constitution d’un vaste empire maritime, avec l’intensification
de l’agriculture et le décollage de l’industrie urbaine
(textile, construction navale, armement, etc.). Au centre de ce
complexe économique, il convient de placer la Banque d’Amsterdam,
d’origine étatique, qui permit de faire du florin banco la
« monnaie du monde » et de drainer l’essentiel des
capitaux européens. Il en a résulté davantage « d’argent
disponible pour les emprunts d’Etat, ce qui [a conféré] à la
République hollandaise une supériorité inestimable sur ses
rivaux », du fait qu’il était « politiquement plus
facile d’encourager au maximum le financement de la guerre par des
emprunts publics. »
Au terme de ce rapide survol historique, trois remarques paraissent s’imposer :
A mesure que se sont développés la monétarisation des économies nationales, les dérivés des monnaies métalliques et des systèmes fiscaux efficaces, le financement militaire s’est émancipé des procédés archaïques du strict monnayage, pour s’inscrire dans les arcanes de la fiscalité et de la finance internationale ;
Le déclin, depuis la Première Guerre mondiale, de la part relative des dépenses militaires dans les budgets publics des Etats conservant des ambitions internationales, ne doit pas masquer, ni la hausse continue de leur volume, ni les progrès de leur puissance de feu, susceptibles de conduire à l’autodestruction de l’humanité ;
La libération des flux internationaux de capitaux et la globalisation financière, en fragilisant la fiscalité des Etats, définissent le contexte contemporain au sein duquel un lien étroit s’est établi entre le contrôle de ces flux et le financement militaire par endettement, qui fait du système monétaire international un enjeu essentiellement politique.
Jacques Luzi
L'homme troué
Trop loin dans l'amour pour qu'il me soit possible
de te toucher
Trop loin dans le désir pour qu'il puisse encore prendre
pour corps le tien
qui est lui-même
revenu à son premier être,
trop loin dans le fond de ta bouche
pour que je puisse encore savoir ce que c'est une bouche
et la prendre
Alain Gheerbrant, L'homme troué.
lundi 30 novembre 2015
Salvador (et ailleurs)
Dragons & Princesses
dimanche 29 novembre 2015
Sud(s)
Navire incertain né de la cicatrice des vagues, mes voiles n'ont qu'un seul port : le Sud, âme de mon âme, où le silence de l'écorce répond au baiser des calanques, où l'écume chante le frôlement des méridiens, le sommeil des tomettes dans l'après-midi, la traversée, la mort, l'exil et ses trafics consciencieux.
On a déniché un coin de soleil, à quoi bon courir après d'autre mal de mer ?